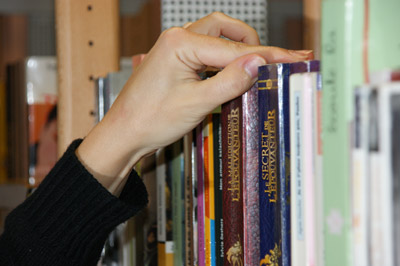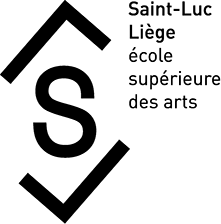ESA SAINT-LUC LIEGE BIBLIOTHEQUE
ACCES COMPTE LECTEUR :
à la demande via l'adresse mail de la bibliothèque.
Catégorie Esthétique -- Recherche
Documents disponibles dans cette catégorie (2)


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externesn°27-28 (2012-2013) - 2012-01-01 - Dossier : Formes et forces – Topologies de l'individuation, Deleuze, Simondon (Bulletin de La part de l'œil)

Titre : n°27-28 (2012-2013) - 2012-01-01 - Dossier : Formes et forces – Topologies de l'individuation, Deleuze, Simondon Type de document : texte imprimé Année de publication : 2012 Importance : 344 p. Présentation : ill. en noir Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Art et sciences -- Recherche
Bacon, Francis (1909-1992)
Chatelet, Gilles (1944-1999)
Colloque international Formes et forces (2009 ; Liège, Belgique)
Corps humain -- Dans l'art -- Recherche
Deleuze, Gilles (1925-1995) -- Critique et interprétation
Esthétique -- Recherche
Formalisme (art)
Foucault, Michel (1926-1984)
Fried, Michael (1939-....)
Granel, Gérard (1930-2000)
Henry, Michel (1922-2002)
Husserl, Edmund (1859-1938)
Lyotard, Jean-François (1924-1998)
Matisse, Henri (1869-1954) -- Thèmes, motifs
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Phénoménologie de l'art
Photographie -- Esthétique
Psychologie de la forme
Simondon, Gilbert (1924-1989)
Whitehead, Alfred North (1861-1947)
Wölfflin, Heinrich (1864-1945)
Worringer, Wilhelm Robert (1881-1965)Index. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : La relation “Formes et forces” est un lieu commun de l’esthétique. Plus de quarante ans après la parution de l’ouvrage éponyme de René Huyghe – ouvrage dont avec le recul se dégage quelque naïveté quant à l’approche des rapports de l’art et de la science –, les patients travaux menés dans le domaine de la pensée de l’art conduisent à élaborer, à partir de cette question, des démarches totalement renouvelées.
On peut trouver les concepts de “forme” et de “force” déjà chez Platon dans l’articulation de la force agissante et de l’Idée. Sans doute attendra-t-on le XIXe siècle, avec Nietzsche et Freud par exemple, pour voir la dynamique formatrice ou créatrice remettre en cause la primauté, jusque là incontestée, de l’instance formelle. Les auteurs de ce dossier aborderont cette question au travers des œuvres de Worringer, Wölfflin, Bergson, Lyotard, Michael Fried, Merleau-Ponty ou encore Levinas et Blanchot.
Ces questions de “forme” et de “force” seront reprises dans la seconde partie du volume en se concentrant sur les relations entre les œuvres de Deleuze et de Simondon. Les collaborations retracent une généalogie de la question de l’individuation remontant aux sources des deux auteurs et révélant leur dette à l’égard de Leibniz, Whitehead, Valéry, Albert Lautman, René Thom, Gilles Châtelet ou encore D’Arcy Thompson pour ne citer que les plus connus.
L’on doit constater que tout se passe comme si l’esthétique s’était simplement détournée de la question de l’individuation pour se pencher systématiquement sur celle de l’interprétation de l’œuvre dans une sorte d’herméneutique généralisée. Non seulement l’esthétique s’est rarement emparée de cette question de l’individuation, mais aussi l’usage qu’il lui arrive parfois de faire des catégories épistémologiques pour pallier à ce défaut, semble si fragile qu’il se confond, à coup d’expédients, avec un discours métaphorique censé lui servir après coup de quelque justification.
Si une esthétique de la réception peut sans doute se satisfaire de l’analyse d’une image arrêtée, d’une forme, d’une Gestalt, de ses significations supposées, l’intérêt pour la logique créatrice, pour la force, la formation, l’individuation ne peut éviter de saisir ce qui opère comme dynamique, comme transformation dans le surgissement des œuvres.Note de contenu : Sommaire
Dossier : Formes et forces
Rudy Steinmetz : Liminaire
Katrie Chagnon : Le conflit phénoménologique de l’œuvre d’art chez Michael Fried
Francis Gaube : Le motif matisséen : une forme aux prises avec des forces
Florent Jakob : Trancher sur la forme ou se laisser fasciner par une seule image : l'intentionnalité comme voie d'accès à l'esthétique
Jacinto Lageira : Les puissances formatives du corps
Danielle Lories : La forme et l’art. Remarques sur le “formalisme” kantien
Claire Pagès : Figural, énergie, affect. Entre force et forme - la figure de Freud et l’inarticulation chez Jean-François Lyotard
Pierre Rodrigo : “Une force lisible dans une forme”. Mouvement et expression dans l'esthétique de Merleau-Ponty
Denis Seron : Phénoménologie de style husserlien et psychologie de la forme : Arguments pro et contra
Rudy Steinmetz : Psychologie, énergie, morphologie et pathologie de l’art
chez Worringer et Wölfflin
Carole Talon-Hugon : La puissance affective des formes. L’abstraction picturale selon la phénoménologie non intentionnelle de Michel Henry
Topologies de l'individuation et plasticité chez Deleuze et Simondon
Jean-Pascal Alcantara : Un schématisme des forces : la fulguration du diagramme, entre Deleuze et Châtelet
Frédéric Bisson : Eléments d’arythmétique. Le rythme selon Whitehead et Deleuze
Jehanne Dautrey : Topologies de l’individuation artistique. Une théorie des catastrophes en art ?
Jean-Claude Dumoncel : Topologie transcendantale & individuation rythmique. Petite métaphysique des vagues océaniques
Judith Michalet & Emmanuel Alloa : Transductive ou intensive ? Penser la différence entre Simondon et Deleuze
Ludovic Duhem : “Entrer dans le moule”. Poïétique et individuation chez Simondon
Varia
Eliane Escoubas : L’archi-phénoménologie de Gérard Granel
Luc Richir : Un savoir insipide : Descartes ou la mort de la philosophie
Alexandre Saint-Jevin : Du “Style documentaire” à la pornographie numérique : la machine désublimatoireEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=23 [n° ou bulletin] n°27-28 (2012-2013) - 2012-01-01 - Dossier : Formes et forces – Topologies de l'individuation, Deleuze, Simondon [texte imprimé] . - 2012 . - 344 p. : ill. en noir ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Art et sciences -- Recherche
Bacon, Francis (1909-1992)
Chatelet, Gilles (1944-1999)
Colloque international Formes et forces (2009 ; Liège, Belgique)
Corps humain -- Dans l'art -- Recherche
Deleuze, Gilles (1925-1995) -- Critique et interprétation
Esthétique -- Recherche
Formalisme (art)
Foucault, Michel (1926-1984)
Fried, Michael (1939-....)
Granel, Gérard (1930-2000)
Henry, Michel (1922-2002)
Husserl, Edmund (1859-1938)
Lyotard, Jean-François (1924-1998)
Matisse, Henri (1869-1954) -- Thèmes, motifs
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Phénoménologie de l'art
Photographie -- Esthétique
Psychologie de la forme
Simondon, Gilbert (1924-1989)
Whitehead, Alfred North (1861-1947)
Wölfflin, Heinrich (1864-1945)
Worringer, Wilhelm Robert (1881-1965)Index. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : La relation “Formes et forces” est un lieu commun de l’esthétique. Plus de quarante ans après la parution de l’ouvrage éponyme de René Huyghe – ouvrage dont avec le recul se dégage quelque naïveté quant à l’approche des rapports de l’art et de la science –, les patients travaux menés dans le domaine de la pensée de l’art conduisent à élaborer, à partir de cette question, des démarches totalement renouvelées.
On peut trouver les concepts de “forme” et de “force” déjà chez Platon dans l’articulation de la force agissante et de l’Idée. Sans doute attendra-t-on le XIXe siècle, avec Nietzsche et Freud par exemple, pour voir la dynamique formatrice ou créatrice remettre en cause la primauté, jusque là incontestée, de l’instance formelle. Les auteurs de ce dossier aborderont cette question au travers des œuvres de Worringer, Wölfflin, Bergson, Lyotard, Michael Fried, Merleau-Ponty ou encore Levinas et Blanchot.
Ces questions de “forme” et de “force” seront reprises dans la seconde partie du volume en se concentrant sur les relations entre les œuvres de Deleuze et de Simondon. Les collaborations retracent une généalogie de la question de l’individuation remontant aux sources des deux auteurs et révélant leur dette à l’égard de Leibniz, Whitehead, Valéry, Albert Lautman, René Thom, Gilles Châtelet ou encore D’Arcy Thompson pour ne citer que les plus connus.
L’on doit constater que tout se passe comme si l’esthétique s’était simplement détournée de la question de l’individuation pour se pencher systématiquement sur celle de l’interprétation de l’œuvre dans une sorte d’herméneutique généralisée. Non seulement l’esthétique s’est rarement emparée de cette question de l’individuation, mais aussi l’usage qu’il lui arrive parfois de faire des catégories épistémologiques pour pallier à ce défaut, semble si fragile qu’il se confond, à coup d’expédients, avec un discours métaphorique censé lui servir après coup de quelque justification.
Si une esthétique de la réception peut sans doute se satisfaire de l’analyse d’une image arrêtée, d’une forme, d’une Gestalt, de ses significations supposées, l’intérêt pour la logique créatrice, pour la force, la formation, l’individuation ne peut éviter de saisir ce qui opère comme dynamique, comme transformation dans le surgissement des œuvres.Note de contenu : Sommaire
Dossier : Formes et forces
Rudy Steinmetz : Liminaire
Katrie Chagnon : Le conflit phénoménologique de l’œuvre d’art chez Michael Fried
Francis Gaube : Le motif matisséen : une forme aux prises avec des forces
Florent Jakob : Trancher sur la forme ou se laisser fasciner par une seule image : l'intentionnalité comme voie d'accès à l'esthétique
Jacinto Lageira : Les puissances formatives du corps
Danielle Lories : La forme et l’art. Remarques sur le “formalisme” kantien
Claire Pagès : Figural, énergie, affect. Entre force et forme - la figure de Freud et l’inarticulation chez Jean-François Lyotard
Pierre Rodrigo : “Une force lisible dans une forme”. Mouvement et expression dans l'esthétique de Merleau-Ponty
Denis Seron : Phénoménologie de style husserlien et psychologie de la forme : Arguments pro et contra
Rudy Steinmetz : Psychologie, énergie, morphologie et pathologie de l’art
chez Worringer et Wölfflin
Carole Talon-Hugon : La puissance affective des formes. L’abstraction picturale selon la phénoménologie non intentionnelle de Michel Henry
Topologies de l'individuation et plasticité chez Deleuze et Simondon
Jean-Pascal Alcantara : Un schématisme des forces : la fulguration du diagramme, entre Deleuze et Châtelet
Frédéric Bisson : Eléments d’arythmétique. Le rythme selon Whitehead et Deleuze
Jehanne Dautrey : Topologies de l’individuation artistique. Une théorie des catastrophes en art ?
Jean-Claude Dumoncel : Topologie transcendantale & individuation rythmique. Petite métaphysique des vagues océaniques
Judith Michalet & Emmanuel Alloa : Transductive ou intensive ? Penser la différence entre Simondon et Deleuze
Ludovic Duhem : “Entrer dans le moule”. Poïétique et individuation chez Simondon
Varia
Eliane Escoubas : L’archi-phénoménologie de Gérard Granel
Luc Richir : Un savoir insipide : Descartes ou la mort de la philosophie
Alexandre Saint-Jevin : Du “Style documentaire” à la pornographie numérique : la machine désublimatoireEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=23 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité SL 27701 Part de l'œil Fascicule ESA Saint-Luc Beaux-Arts - Biblio Disponible n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image (Bulletin de La part de l'œil)


Titre : n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image Type de document : texte imprimé Année de publication : 2025 Note générale : Auteur(s) : Alain Cantillon, Giovanni Careri, Maxime Cartron, Tom Conley, Laurent David, Stefano de Bosio, Vincent Debiais, Danielle Desloges, Florence Dumora, Pierre-Antoine Fabre, Jérémie Ferrer-Bartomeu, Giorgio Fichera, Giacomo Fuk, Agnès Guiderdoni, François Herreman, Adnen Jdey, Lionel Maes, Laura Marin, Cécile Massart, Isabelle Ost, Jorge Rizo Martinez , Nigel Saint, Benoit Tane, Baptiste Tochon-Danguy, Bernard Vouilloux Langues : Français (fre) Catégories : Art et littérature
Déchets radioactifs -- Dans l'art -- 21e siècle
Esthétique -- Recherche
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Littératie visuelle
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 741 Dessin Résumé : Le philosophe Louis Marin (1931-1992) a été surtout identifié comme un théoricien de l’image. Autour de 1990, Norman Bryson le rapprochait de la « New Art History » anglophone et Thomas Mitchell le citait parmi ceux qui auraient secoué l’histoire de l’art de son « sommeil dogmatique ». En France, Marin a été la source importante d’un renouvellement de l’histoire de l’art, surtout parmi ceux qui ont voulu se démarquer de l’autorité par exemple d’André Chastel. On trouve cependant également son influence dans d’autres domaines, à commencer par la littérature, à travers ses travaux sur Pascal et Port-Royal, Montaigne, Stendhal, Perrault ou La Fontaine, pour ne citer que quelques exemples. On constate toutefois que dans ce domaine aussi, c’est en quelque sorte l’image qui est au cœur de ses préoccupations, jetant les bases d’une reconsidération radicale de ce qu’on appelle de manière souvent figée « les relations texte-image ». Des auteurs comme Bernard Vouilloux ou Bertrand Rougé inscrivent ainsi leurs travaux dans ce sillage.
Si cette reconsidération des relations entre texte et image est si radicale, c’est que Marin a été un théoricien moins de l’image que de la figure (pour utiliser un terme largement employé par lui-même, ressortissant aussi bien à la rhétorique qu’à la théorie de l’art et à la théologie), c’est-à-dire le théoricien du lieu où s’entrecroisent l’image et la parole, la perception et le langage, le regard et l’écriture – le lieu de leur « concrétion », pour reprendre son vocabulaire. C’est d’un autre rapport entre ces deux plans essentiels du sens dont il est question dans ses écrits ; autre, du moins, que celui postulé par une histoire de l’art dont Erwin Panofsky est souvent présenté, à tort ou à raison, comme le patriarche : une historiographie où le texte se situe en amont de l’œuvre d’art, comme son explication, comme le code de sa lecture, alors que ce qui s’affirme chez Marin est une configuration où l’œuvre et le discours (ou le texte et l’image à l’intérieur d’une œuvre) renvoient l’une à l’autre sans qu’une véritable priorité ne puisse jamais s’établir. Il rejoint par là un programme que Roland Barthes avait ouvertement formulé pour la critique littéraire au moins dès 1963 : remplacer l’analogie entre des parties d’une œuvre et des documents extérieurs à celle-ci par l’homologie entre la totalité de l’œuvre et d’autres totalités (discursives, sociales, historiques, psychiques,…).
Ce volume se propose d’explorer les apparitions et transformations de ce jeu du texte et de l’image à partir de Louis Marin, mais aussi de les situer dans une multiplicité de tentatives visant à reconfigurer les liens entre image et texte, œuvre et discours, art et littérature.Note de contenu : Sommaire :
Agnès Guiderdoni & Giacomo Fuk : Introduction
Bernard Vouilloux : L’image comme problème
Laura Marin : Décrire une image, écrire un regard
Baptiste Tochon-Danguy : De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard
Giorgio Fichera : Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles
Benoît Tane : Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ?
Laurent David & Lionel Maes : Méthode
Adnen Jdey : Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l’oeil ? Marin lecteur de Husserl
Stefano De Bosio : “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin
Vincent Debiais : Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ?
François Herreman :Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature
Danielle Desloges :Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin
Jorge Rizo-Martinez : Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome
Isabelle Ost : Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie
Cécile Massart : Un site archivé
Nigel Saint : Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer
Florence Dumora : Pouvoirs du comme chez Louis Marin et La Fontaine : « Le statuaire et la statue de Jupiter »
Jérémie Ferrer-Bartomeu : La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité)
Maxime Cartron : Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique
Tom Conley : Gloses et entreglose. Lire et voir Des pouvoirs de l’image
Alain Cantillon, Giovanni Careri & Pierre-Antoine Fabre : Héritage de Louis Marin | Entretien avec Alain Cantillon, Giovanni Careri et Pierre-Antoine FabreEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=32 [n° ou bulletin] n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image [texte imprimé] . - 2025.
Auteur(s) : Alain Cantillon, Giovanni Careri, Maxime Cartron, Tom Conley, Laurent David, Stefano de Bosio, Vincent Debiais, Danielle Desloges, Florence Dumora, Pierre-Antoine Fabre, Jérémie Ferrer-Bartomeu, Giorgio Fichera, Giacomo Fuk, Agnès Guiderdoni, François Herreman, Adnen Jdey, Lionel Maes, Laura Marin, Cécile Massart, Isabelle Ost, Jorge Rizo Martinez , Nigel Saint, Benoit Tane, Baptiste Tochon-Danguy, Bernard Vouilloux
Langues : Français (fre)
Catégories : Art et littérature
Déchets radioactifs -- Dans l'art -- 21e siècle
Esthétique -- Recherche
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Littératie visuelle
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 741 Dessin Résumé : Le philosophe Louis Marin (1931-1992) a été surtout identifié comme un théoricien de l’image. Autour de 1990, Norman Bryson le rapprochait de la « New Art History » anglophone et Thomas Mitchell le citait parmi ceux qui auraient secoué l’histoire de l’art de son « sommeil dogmatique ». En France, Marin a été la source importante d’un renouvellement de l’histoire de l’art, surtout parmi ceux qui ont voulu se démarquer de l’autorité par exemple d’André Chastel. On trouve cependant également son influence dans d’autres domaines, à commencer par la littérature, à travers ses travaux sur Pascal et Port-Royal, Montaigne, Stendhal, Perrault ou La Fontaine, pour ne citer que quelques exemples. On constate toutefois que dans ce domaine aussi, c’est en quelque sorte l’image qui est au cœur de ses préoccupations, jetant les bases d’une reconsidération radicale de ce qu’on appelle de manière souvent figée « les relations texte-image ». Des auteurs comme Bernard Vouilloux ou Bertrand Rougé inscrivent ainsi leurs travaux dans ce sillage.
Si cette reconsidération des relations entre texte et image est si radicale, c’est que Marin a été un théoricien moins de l’image que de la figure (pour utiliser un terme largement employé par lui-même, ressortissant aussi bien à la rhétorique qu’à la théorie de l’art et à la théologie), c’est-à-dire le théoricien du lieu où s’entrecroisent l’image et la parole, la perception et le langage, le regard et l’écriture – le lieu de leur « concrétion », pour reprendre son vocabulaire. C’est d’un autre rapport entre ces deux plans essentiels du sens dont il est question dans ses écrits ; autre, du moins, que celui postulé par une histoire de l’art dont Erwin Panofsky est souvent présenté, à tort ou à raison, comme le patriarche : une historiographie où le texte se situe en amont de l’œuvre d’art, comme son explication, comme le code de sa lecture, alors que ce qui s’affirme chez Marin est une configuration où l’œuvre et le discours (ou le texte et l’image à l’intérieur d’une œuvre) renvoient l’une à l’autre sans qu’une véritable priorité ne puisse jamais s’établir. Il rejoint par là un programme que Roland Barthes avait ouvertement formulé pour la critique littéraire au moins dès 1963 : remplacer l’analogie entre des parties d’une œuvre et des documents extérieurs à celle-ci par l’homologie entre la totalité de l’œuvre et d’autres totalités (discursives, sociales, historiques, psychiques,…).
Ce volume se propose d’explorer les apparitions et transformations de ce jeu du texte et de l’image à partir de Louis Marin, mais aussi de les situer dans une multiplicité de tentatives visant à reconfigurer les liens entre image et texte, œuvre et discours, art et littérature.Note de contenu : Sommaire :
Agnès Guiderdoni & Giacomo Fuk : Introduction
Bernard Vouilloux : L’image comme problème
Laura Marin : Décrire une image, écrire un regard
Baptiste Tochon-Danguy : De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard
Giorgio Fichera : Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles
Benoît Tane : Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ?
Laurent David & Lionel Maes : Méthode
Adnen Jdey : Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l’oeil ? Marin lecteur de Husserl
Stefano De Bosio : “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin
Vincent Debiais : Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ?
François Herreman :Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature
Danielle Desloges :Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin
Jorge Rizo-Martinez : Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome
Isabelle Ost : Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie
Cécile Massart : Un site archivé
Nigel Saint : Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer
Florence Dumora : Pouvoirs du comme chez Louis Marin et La Fontaine : « Le statuaire et la statue de Jupiter »
Jérémie Ferrer-Bartomeu : La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité)
Maxime Cartron : Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique
Tom Conley : Gloses et entreglose. Lire et voir Des pouvoirs de l’image
Alain Cantillon, Giovanni Careri & Pierre-Antoine Fabre : Héritage de Louis Marin | Entretien avec Alain Cantillon, Giovanni Careri et Pierre-Antoine FabreEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=32
- L’image comme problème / Bernard Vouilloux in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Décrire une image, écrire un regard / Laura Marin in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard / Baptiste Tochon-Danguy in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles / Giorgio Fichera in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ? / Benoît Tane in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l'œil ? Marin lecteur de Husserl / Adnen Jdey in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin / Stefano De Bosio in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ? / Vincent Debiais in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature / François Herreman in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin / Danielle Desloges in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome / Jorge Rizo Martinez in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie / Isabelle Ost in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer / Nigel Saint in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité) / Jérémie Ferrer-Bartomeu in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique / Maxime Cartron in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité SL 28241 Part de l'œil Fascicule ESA Saint-Luc Beaux-Arts - Biblio Disponible