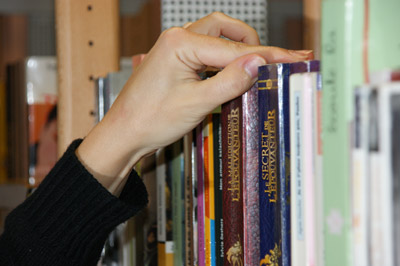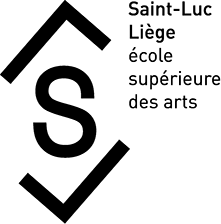ESA SAINT-LUC LIEGE BIBLIOTHEQUE
ACCES COMPTE LECTEUR :
à la demande via l'adresse mail de la bibliothèque.
Catégorie Sémiotique et art -- Recherche
Documents disponibles dans cette catégorie (7)


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externesDu Chaos à l’(in)intelligibilité catastrophique de l’art / Stefania Caliandro in La part de l'œil, n°38 (2024) (2024-03-2024)
n°31 (2017-2018) - 2017-01-01 - Dossier : « Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image » (Bulletin de La part de l'œil)

Titre : n°31 (2017-2018) - 2017-01-01 - Dossier : « Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image » Type de document : texte imprimé Année de publication : 2017 Importance : 288 p. Présentation : ill. en n. et bl. et coul. Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Barthes, Roland (1915-1980)
De Bruyckere, Berlinde (1964-....)
Figures (perception visuelle) -- Dans l'art -- Recherche
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : Présentation du dossier
Dans une étude fondatrice, Erich Auerbach décrivait l’évolution philologique du mot figura de ses origines jusqu’à la fin du moyen âge et, ce faisant, identifiait une notion centrale de l’histoire des représentations en Occident. Il y mettait en évidence comment cette figure prend son origine dans une interprétation spirituelle de l’histoire sainte pour devenir, par transfert, un mode de représentation. Ainsi est-elle le produit d’une “alliance de spiritualité et de sens du réelˮ, d’où l’indétermination et l’ouverture qui en constituent la richesse et la complexité. Une telle enquête historique et sémantique peut être prolongée vers la période de transition que constitue la première modernité (XVe-XVIIe siècles). On assiste alors à d’importants glissements de sens qui participent à la constitution des grands champs du savoir, lesquels n’en continuent pas moins de communiquer entre eux, notamment par le biais d’une réflexion commune sur les enjeux de la représentation. La pertinence d’observer les mutations de la figura sur cette période est d’autant plus grande qu’apparaissent alors non seulement de nouveaux genres iconotextuels, comme l’emblématique, mais plus fondamentalement un nouveau mode de penser (dont témoignent ces genres), issu d’une refondation de la pensée figurée dans les termes d’une “symbolique humanisteˮ (ars symbolica), importante à tel point que certains n’ont pas hésité à identifier une aetas emblematica afin de marquer l’imprégnation de ce mode de penser dans tous les domaines de la culture européenne. Par ce biais, la figure, tout à la fois rhétorique, théologique et visuelle, informe profondément l’ensemble des représentations, dans leurs formes et dans leurs sens, produisant en leur sein un champ de tensions et de forces se manifestant à travers des processus d’échanges et de contamination entre ses trois dimensions. Cette prégnance de la figure et de ce travail entre rhétorique, herméneutique et poétique fait en outre émerger une pensée spécifique de la représentation dont les théories s’en trouvent développées et bouleversées entre XVe et XVIe siècles. C’est ainsi que l’on passe du champ de forces de la figura à la mise en valeur du travail de la figurabilité, et que se trouve ex-pliquée leur relation substantielle, impliquée par la dimension protéiforme de la figura ancienne.
Entamer et concentrer l’enquête sur le début de la période moderne présente donc un double enjeu, historique et historiographique, ce à quoi ce dossier entend s’attacher. Peut-on d’une part définir des régimes historiques de la figurabilité, ancrés dans les transformations de la figura ? Quelles en seraient les modalités ? L’historicisation permet de mieux comprendre le lien fort entre figura et figurabilité, et ainsi de réintégrer dans la réflexion théorique d’autres composantes de cette figurabilité, qui en accroissent la complexité et renforcent son positionnement au cœur d’une configuration épistémique, dont les paramètres changent au cours du temps. L’enjeu historiographique consiste d’autre part en un retour critique sur l’élaboration de la figurabilité chez des auteurs qui ont renouvelé profondément l’interprétation des images et des textes, tant en amont qu’en aval du tournant freudien. Si le concept n’a été formellement théorisé et utilisé dans les études des arts visuels et poétiques qu’au XXe siècle, il n’en est pas moins déjà élaboré sous d’autres vocables et dans d’autres définitions, précisément par le biais des mutations de la figura.
Agnès Guiderdoni et Ralph DekoninckNote de contenu : Sommaire
Dossier : Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image
Ralph Dekoninck & Agnès Guiderdoni : Introduction
Florence Dumora : Force de rêve. Rêve, figural et figurabilité
Bernard Vouilloux : Représenter et figurer
Bertrand Rougé : La dislocation figurative. L'énergie de la Figuration contre "la fin de l'art"
Daniele Guastini : Transfiguration, figure, figurabilité chez Louis Marin
Bertrand Prévost : Figure, figura, figurabilité. Contribution à une théorie des intensités visuelles
Sara Longo : "Figurer l'infigurable comme infigurable". Quelques réflexions sur la trajectoire de la colombe du Saint Esprit dans les Annonciations italiennes au temps de l'invention de la perspective
Alain Cantillon : Le vide en ses figures
Xavier Vert : Devenir, perversion et physionomies dernières : Figurer l’enfer dans la chapelle Sixtine
Michel Weemans : La fumée du sacrifice. Double image et figurabilité dans Le sacrifice de Caïn et Abel de Karel de Mallery pour les Tableaux sacrez (1601) de Louis Richeome
Bruno Nassim Aboudrar : Moins que la figure
Angela Mengoni : L’inachevé toujours là. Figurabilité et montage chez Berlinde De Bruyckere
Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry
John Dixon Hunt, Michèle Hannoosh, Catriona MacLeod : Word & Image a 32 ans
Sophie Aymes : Évolution de la critique intermédiale dans Word & Image : le cas de l'illustration
John Dixon Hunt : Les architectes paysagistes peuvent-ils ôter les voiles d'Isis ?
Varia
Marion Colas-Blaise et Maria Giulia Dondero : L’événement énonciatif en sémiotique de l’image : de Roland Barthes à la sémiotique tensive
Filippo Fimiani : Le trop engendre le néant. De la sensibilité des modernes
Chakè Matossian : “Invisible mais présent en esprit” : le Séducteur de Kierkegaard
Élodie Simon : De l'instance motivique du geste à la composition gestuelle du motifEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=26 [n° ou bulletin] n°31 (2017-2018) - 2017-01-01 - Dossier : « Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image » [texte imprimé] . - 2017 . - 288 p. : ill. en n. et bl. et coul. ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Barthes, Roland (1915-1980)
De Bruyckere, Berlinde (1964-....)
Figures (perception visuelle) -- Dans l'art -- Recherche
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : Présentation du dossier
Dans une étude fondatrice, Erich Auerbach décrivait l’évolution philologique du mot figura de ses origines jusqu’à la fin du moyen âge et, ce faisant, identifiait une notion centrale de l’histoire des représentations en Occident. Il y mettait en évidence comment cette figure prend son origine dans une interprétation spirituelle de l’histoire sainte pour devenir, par transfert, un mode de représentation. Ainsi est-elle le produit d’une “alliance de spiritualité et de sens du réelˮ, d’où l’indétermination et l’ouverture qui en constituent la richesse et la complexité. Une telle enquête historique et sémantique peut être prolongée vers la période de transition que constitue la première modernité (XVe-XVIIe siècles). On assiste alors à d’importants glissements de sens qui participent à la constitution des grands champs du savoir, lesquels n’en continuent pas moins de communiquer entre eux, notamment par le biais d’une réflexion commune sur les enjeux de la représentation. La pertinence d’observer les mutations de la figura sur cette période est d’autant plus grande qu’apparaissent alors non seulement de nouveaux genres iconotextuels, comme l’emblématique, mais plus fondamentalement un nouveau mode de penser (dont témoignent ces genres), issu d’une refondation de la pensée figurée dans les termes d’une “symbolique humanisteˮ (ars symbolica), importante à tel point que certains n’ont pas hésité à identifier une aetas emblematica afin de marquer l’imprégnation de ce mode de penser dans tous les domaines de la culture européenne. Par ce biais, la figure, tout à la fois rhétorique, théologique et visuelle, informe profondément l’ensemble des représentations, dans leurs formes et dans leurs sens, produisant en leur sein un champ de tensions et de forces se manifestant à travers des processus d’échanges et de contamination entre ses trois dimensions. Cette prégnance de la figure et de ce travail entre rhétorique, herméneutique et poétique fait en outre émerger une pensée spécifique de la représentation dont les théories s’en trouvent développées et bouleversées entre XVe et XVIe siècles. C’est ainsi que l’on passe du champ de forces de la figura à la mise en valeur du travail de la figurabilité, et que se trouve ex-pliquée leur relation substantielle, impliquée par la dimension protéiforme de la figura ancienne.
Entamer et concentrer l’enquête sur le début de la période moderne présente donc un double enjeu, historique et historiographique, ce à quoi ce dossier entend s’attacher. Peut-on d’une part définir des régimes historiques de la figurabilité, ancrés dans les transformations de la figura ? Quelles en seraient les modalités ? L’historicisation permet de mieux comprendre le lien fort entre figura et figurabilité, et ainsi de réintégrer dans la réflexion théorique d’autres composantes de cette figurabilité, qui en accroissent la complexité et renforcent son positionnement au cœur d’une configuration épistémique, dont les paramètres changent au cours du temps. L’enjeu historiographique consiste d’autre part en un retour critique sur l’élaboration de la figurabilité chez des auteurs qui ont renouvelé profondément l’interprétation des images et des textes, tant en amont qu’en aval du tournant freudien. Si le concept n’a été formellement théorisé et utilisé dans les études des arts visuels et poétiques qu’au XXe siècle, il n’en est pas moins déjà élaboré sous d’autres vocables et dans d’autres définitions, précisément par le biais des mutations de la figura.
Agnès Guiderdoni et Ralph DekoninckNote de contenu : Sommaire
Dossier : Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image
Ralph Dekoninck & Agnès Guiderdoni : Introduction
Florence Dumora : Force de rêve. Rêve, figural et figurabilité
Bernard Vouilloux : Représenter et figurer
Bertrand Rougé : La dislocation figurative. L'énergie de la Figuration contre "la fin de l'art"
Daniele Guastini : Transfiguration, figure, figurabilité chez Louis Marin
Bertrand Prévost : Figure, figura, figurabilité. Contribution à une théorie des intensités visuelles
Sara Longo : "Figurer l'infigurable comme infigurable". Quelques réflexions sur la trajectoire de la colombe du Saint Esprit dans les Annonciations italiennes au temps de l'invention de la perspective
Alain Cantillon : Le vide en ses figures
Xavier Vert : Devenir, perversion et physionomies dernières : Figurer l’enfer dans la chapelle Sixtine
Michel Weemans : La fumée du sacrifice. Double image et figurabilité dans Le sacrifice de Caïn et Abel de Karel de Mallery pour les Tableaux sacrez (1601) de Louis Richeome
Bruno Nassim Aboudrar : Moins que la figure
Angela Mengoni : L’inachevé toujours là. Figurabilité et montage chez Berlinde De Bruyckere
Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry
John Dixon Hunt, Michèle Hannoosh, Catriona MacLeod : Word & Image a 32 ans
Sophie Aymes : Évolution de la critique intermédiale dans Word & Image : le cas de l'illustration
John Dixon Hunt : Les architectes paysagistes peuvent-ils ôter les voiles d'Isis ?
Varia
Marion Colas-Blaise et Maria Giulia Dondero : L’événement énonciatif en sémiotique de l’image : de Roland Barthes à la sémiotique tensive
Filippo Fimiani : Le trop engendre le néant. De la sensibilité des modernes
Chakè Matossian : “Invisible mais présent en esprit” : le Séducteur de Kierkegaard
Élodie Simon : De l'instance motivique du geste à la composition gestuelle du motifEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=26 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité SL 27702 Part de l'œil Fascicule ESA Saint-Luc Beaux-Arts - Biblio Disponible n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image (Bulletin de La part de l'œil)


Titre : n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image Type de document : texte imprimé Année de publication : 2025 Note générale : Auteur(s) : Alain Cantillon, Giovanni Careri, Maxime Cartron, Tom Conley, Laurent David, Stefano de Bosio, Vincent Debiais, Danielle Desloges, Florence Dumora, Pierre-Antoine Fabre, Jérémie Ferrer-Bartomeu, Giorgio Fichera, Giacomo Fuk, Agnès Guiderdoni, François Herreman, Adnen Jdey, Lionel Maes, Laura Marin, Cécile Massart, Isabelle Ost, Jorge Rizo Martinez , Nigel Saint, Benoit Tane, Baptiste Tochon-Danguy, Bernard Vouilloux Langues : Français (fre) Catégories : Art et littérature
Déchets radioactifs -- Dans l'art -- 21e siècle
Esthétique -- Recherche
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Littératie visuelle
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 741 Dessin Résumé : Le philosophe Louis Marin (1931-1992) a été surtout identifié comme un théoricien de l’image. Autour de 1990, Norman Bryson le rapprochait de la « New Art History » anglophone et Thomas Mitchell le citait parmi ceux qui auraient secoué l’histoire de l’art de son « sommeil dogmatique ». En France, Marin a été la source importante d’un renouvellement de l’histoire de l’art, surtout parmi ceux qui ont voulu se démarquer de l’autorité par exemple d’André Chastel. On trouve cependant également son influence dans d’autres domaines, à commencer par la littérature, à travers ses travaux sur Pascal et Port-Royal, Montaigne, Stendhal, Perrault ou La Fontaine, pour ne citer que quelques exemples. On constate toutefois que dans ce domaine aussi, c’est en quelque sorte l’image qui est au cœur de ses préoccupations, jetant les bases d’une reconsidération radicale de ce qu’on appelle de manière souvent figée « les relations texte-image ». Des auteurs comme Bernard Vouilloux ou Bertrand Rougé inscrivent ainsi leurs travaux dans ce sillage.
Si cette reconsidération des relations entre texte et image est si radicale, c’est que Marin a été un théoricien moins de l’image que de la figure (pour utiliser un terme largement employé par lui-même, ressortissant aussi bien à la rhétorique qu’à la théorie de l’art et à la théologie), c’est-à-dire le théoricien du lieu où s’entrecroisent l’image et la parole, la perception et le langage, le regard et l’écriture – le lieu de leur « concrétion », pour reprendre son vocabulaire. C’est d’un autre rapport entre ces deux plans essentiels du sens dont il est question dans ses écrits ; autre, du moins, que celui postulé par une histoire de l’art dont Erwin Panofsky est souvent présenté, à tort ou à raison, comme le patriarche : une historiographie où le texte se situe en amont de l’œuvre d’art, comme son explication, comme le code de sa lecture, alors que ce qui s’affirme chez Marin est une configuration où l’œuvre et le discours (ou le texte et l’image à l’intérieur d’une œuvre) renvoient l’une à l’autre sans qu’une véritable priorité ne puisse jamais s’établir. Il rejoint par là un programme que Roland Barthes avait ouvertement formulé pour la critique littéraire au moins dès 1963 : remplacer l’analogie entre des parties d’une œuvre et des documents extérieurs à celle-ci par l’homologie entre la totalité de l’œuvre et d’autres totalités (discursives, sociales, historiques, psychiques,…).
Ce volume se propose d’explorer les apparitions et transformations de ce jeu du texte et de l’image à partir de Louis Marin, mais aussi de les situer dans une multiplicité de tentatives visant à reconfigurer les liens entre image et texte, œuvre et discours, art et littérature.Note de contenu : Sommaire :
Agnès Guiderdoni & Giacomo Fuk : Introduction
Bernard Vouilloux : L’image comme problème
Laura Marin : Décrire une image, écrire un regard
Baptiste Tochon-Danguy : De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard
Giorgio Fichera : Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles
Benoît Tane : Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ?
Laurent David & Lionel Maes : Méthode
Adnen Jdey : Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l’oeil ? Marin lecteur de Husserl
Stefano De Bosio : “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin
Vincent Debiais : Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ?
François Herreman :Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature
Danielle Desloges :Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin
Jorge Rizo-Martinez : Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome
Isabelle Ost : Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie
Cécile Massart : Un site archivé
Nigel Saint : Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer
Florence Dumora : Pouvoirs du comme chez Louis Marin et La Fontaine : « Le statuaire et la statue de Jupiter »
Jérémie Ferrer-Bartomeu : La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité)
Maxime Cartron : Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique
Tom Conley : Gloses et entreglose. Lire et voir Des pouvoirs de l’image
Alain Cantillon, Giovanni Careri & Pierre-Antoine Fabre : Héritage de Louis Marin | Entretien avec Alain Cantillon, Giovanni Careri et Pierre-Antoine FabreEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=32 [n° ou bulletin] n°39 (2025) - 2025-03-01 - Dossier : Lire, décrire, interpréter. Louis Marin entre texte et image [texte imprimé] . - 2025.
Auteur(s) : Alain Cantillon, Giovanni Careri, Maxime Cartron, Tom Conley, Laurent David, Stefano de Bosio, Vincent Debiais, Danielle Desloges, Florence Dumora, Pierre-Antoine Fabre, Jérémie Ferrer-Bartomeu, Giorgio Fichera, Giacomo Fuk, Agnès Guiderdoni, François Herreman, Adnen Jdey, Lionel Maes, Laura Marin, Cécile Massart, Isabelle Ost, Jorge Rizo Martinez , Nigel Saint, Benoit Tane, Baptiste Tochon-Danguy, Bernard Vouilloux
Langues : Français (fre)
Catégories : Art et littérature
Déchets radioactifs -- Dans l'art -- 21e siècle
Esthétique -- Recherche
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Littératie visuelle
Marin, Louis (1931-1992)
Sémiotique et art -- RechercheIndex. décimale : 741 Dessin Résumé : Le philosophe Louis Marin (1931-1992) a été surtout identifié comme un théoricien de l’image. Autour de 1990, Norman Bryson le rapprochait de la « New Art History » anglophone et Thomas Mitchell le citait parmi ceux qui auraient secoué l’histoire de l’art de son « sommeil dogmatique ». En France, Marin a été la source importante d’un renouvellement de l’histoire de l’art, surtout parmi ceux qui ont voulu se démarquer de l’autorité par exemple d’André Chastel. On trouve cependant également son influence dans d’autres domaines, à commencer par la littérature, à travers ses travaux sur Pascal et Port-Royal, Montaigne, Stendhal, Perrault ou La Fontaine, pour ne citer que quelques exemples. On constate toutefois que dans ce domaine aussi, c’est en quelque sorte l’image qui est au cœur de ses préoccupations, jetant les bases d’une reconsidération radicale de ce qu’on appelle de manière souvent figée « les relations texte-image ». Des auteurs comme Bernard Vouilloux ou Bertrand Rougé inscrivent ainsi leurs travaux dans ce sillage.
Si cette reconsidération des relations entre texte et image est si radicale, c’est que Marin a été un théoricien moins de l’image que de la figure (pour utiliser un terme largement employé par lui-même, ressortissant aussi bien à la rhétorique qu’à la théorie de l’art et à la théologie), c’est-à-dire le théoricien du lieu où s’entrecroisent l’image et la parole, la perception et le langage, le regard et l’écriture – le lieu de leur « concrétion », pour reprendre son vocabulaire. C’est d’un autre rapport entre ces deux plans essentiels du sens dont il est question dans ses écrits ; autre, du moins, que celui postulé par une histoire de l’art dont Erwin Panofsky est souvent présenté, à tort ou à raison, comme le patriarche : une historiographie où le texte se situe en amont de l’œuvre d’art, comme son explication, comme le code de sa lecture, alors que ce qui s’affirme chez Marin est une configuration où l’œuvre et le discours (ou le texte et l’image à l’intérieur d’une œuvre) renvoient l’une à l’autre sans qu’une véritable priorité ne puisse jamais s’établir. Il rejoint par là un programme que Roland Barthes avait ouvertement formulé pour la critique littéraire au moins dès 1963 : remplacer l’analogie entre des parties d’une œuvre et des documents extérieurs à celle-ci par l’homologie entre la totalité de l’œuvre et d’autres totalités (discursives, sociales, historiques, psychiques,…).
Ce volume se propose d’explorer les apparitions et transformations de ce jeu du texte et de l’image à partir de Louis Marin, mais aussi de les situer dans une multiplicité de tentatives visant à reconfigurer les liens entre image et texte, œuvre et discours, art et littérature.Note de contenu : Sommaire :
Agnès Guiderdoni & Giacomo Fuk : Introduction
Bernard Vouilloux : L’image comme problème
Laura Marin : Décrire une image, écrire un regard
Baptiste Tochon-Danguy : De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard
Giorgio Fichera : Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles
Benoît Tane : Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ?
Laurent David & Lionel Maes : Méthode
Adnen Jdey : Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l’oeil ? Marin lecteur de Husserl
Stefano De Bosio : “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin
Vincent Debiais : Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ?
François Herreman :Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature
Danielle Desloges :Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin
Jorge Rizo-Martinez : Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome
Isabelle Ost : Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie
Cécile Massart : Un site archivé
Nigel Saint : Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer
Florence Dumora : Pouvoirs du comme chez Louis Marin et La Fontaine : « Le statuaire et la statue de Jupiter »
Jérémie Ferrer-Bartomeu : La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité)
Maxime Cartron : Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique
Tom Conley : Gloses et entreglose. Lire et voir Des pouvoirs de l’image
Alain Cantillon, Giovanni Careri & Pierre-Antoine Fabre : Héritage de Louis Marin | Entretien avec Alain Cantillon, Giovanni Careri et Pierre-Antoine FabreEn ligne : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues_details.php?vid=32
- L’image comme problème / Bernard Vouilloux in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Décrire une image, écrire un regard / Laura Marin in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- De la tête coupée au lac immobile : instant, temps et éternité chez Louis Marin, entre discours et regard / Baptiste Tochon-Danguy in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Adresse queer et opacité du genre dans la peinture à Rome entre le XVIe et le XVIIe siècles / Giorgio Fichera in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Schefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ? / Benoît Tane in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Entre théorie de la représentation et histoire de l’art :une phénoménologie en trompe-l'œil ? Marin lecteur de Husserl / Adnen Jdey in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- “Un corps endormi”. Jalons pour une anthropologie du tableau chez Louis Marin à partir de Poussin / Stefano De Bosio in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Le Moyen Âge, avec ou sans Louis Marin ? / Vincent Debiais in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Lire Marin pour voir Titien : peinture, sculpture, signature / François Herreman in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Les nuages sombres comme figures de la peste dans l’art vénitien de la Renaissance : une illustration de la pensée de Louis Marin / Danielle Desloges in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Les “images sonores” dans le Pelerin de Lorette, de Louis Richeome / Jorge Rizo Martinez in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Louis Marin et la représentation cartographique. Entre transparence et opacité, idéologie et utopie / Isabelle Ost in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Lire Louis Marin avec Pierre Fédida : écouter, écrire, dialoguer / Nigel Saint in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- La figure du ministre ou le troisième corps du roi. Contribution à l’histoire des représentations et des matérialités politiques (Europe, première modernité) / Jérémie Ferrer-Bartomeu in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
- Baroques et classicismes chez Louis Marin : vers une essence du politique / Maxime Cartron in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité SL 28241 Part de l'œil Fascicule ESA Saint-Luc Beaux-Arts - Biblio Disponible n°32 (2018-2019) - 2018-11-01 - Dossier : « L’œuvre d’art entre structure et histoire » et « Greimas et la sémiotique de l’image » (Bulletin de La part de l'œil)

Titre : n°32 (2018-2019) - 2018-11-01 - Dossier : « L’œuvre d’art entre structure et histoire » et « Greimas et la sémiotique de l’image » Type de document : texte imprimé Année de publication : 2018 Langues : Français (fre) Catégories : Abonnenc, Mathieu K. (1977-....)
Anthropologie structurale
Archives -- Dans l'art -- Histoire et critique
Art -- Historiographie -- Histoire et critique
Art -- Recherche
Art et anthropologie -- Recherche
Art et littérature
Art mobilier préhistorique
Arts et histoire
Avant-garde (esthétique) -- Russie -- 1921-1953
Beau (esthétique)
Boehm, Gottfried (1942-....)
Buñuel, Luis (1900-1983). Le fantôme de la liberté
Chronologie -- Dans l'art
Constructivisme (art)
Constructivisme (art) -- URSS -- 20e siècle
Cranach, Lucas (1472-1553). Nymphe de la rivière allongée près de la fontaine
Déconstruction
Deleuze, Gilles (1925-1995) -- Critique et interprétation
Derrida, Jacques (1930-2004) -- Critique et interprétation
Dessin au crayon -- Guyane -- 21e siècle
Didi-Huberman, Georges (1953-....) -- Critique et interprétation
Domingues, Miguel Antonio (1982-....)
Duchamp, Marcel (1887-1968) -- Critique et interprétation
Duchamp, Marcel (1887-1968) -- Influence
École de Nice (mouvement artistique) -- Expositions -- Histoire et critique
Empreinte (art)
Espace (philosophie)
Esthétique -- 20e siècle -- Histoire et critique
Forme (esthétique)
Foucault, Michel (1926-1984) -- Et l'art
Gabo, Naum (1890-1977)
Greimas, Algirdas Julien (1917-1992). Sémantique structurale
Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
Husserl, Edmund (1859-1938)
Icônes (linguistique)
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Image (philosophie)
Installations (art) -- Bruxelles (Belgique) -- 21e siècle
Installations (art) -- Bruxelles (Belgique) -- Photographies
Kierkegaard, Søren (1813-1855) -- Et l'art
Klee, Paul (1879-1940)
Klein, Yves (1928-1962)
Leroi-Gourhan, André (1911-1986)
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781). Laokoon
Lévi-Strauss, Claude (1908 - 2009)
Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935)
Masques kwakiutl
Michel-Ange (1475-1564). Les Ancêtres du Christ
Musique -- Philosophie et esthétique
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). La Naissance de la tragédie
Perception (philosophie)
Philosophie de l'art
Portraits (peinture) baroques -- 16e siècle -- Aspect symbolique
Postcolonialisme et arts -- France -- Histoire et critique
Pouvoir (philosophie)
Reste (esthétique)
Retouche (photographie) -- Aspect symbolique
Scénographie d'exposition -- Histoire et critique
Sedira, Zineb (1963-....) -- Autobiographie -- Algérie
Sémiotique et art -- Recherche
Séries chronologiques -- Dans l'art
Structuralisme -- France -- 1968 (Journées de mai)
Structuralisme -- Recherche
Structuralisme et musique -- Critique et interprétation
Synchronicité -- Dans l'art
Temps (philosophie)
Tragédie grecque -- Histoire et critique -- Aspect philosophique
Tran, Thu Van (1979-....)
Vietnam -- Politique et gouvernement -- 1975-....
Vigo, Jean (1905-1934). L'AtalanteIndex. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : Le structuralisme a constitué un moment marquant de la pensée du XXe siècle opérant un nouage stimulant entre la linguistique, l’anthropologie, la psychanalyse et la philosophie. La notion de structure et ses postulats ont ainsi conduit à une critique à l’égard de la « forme ». Dans l’article décisif « La structure et la forme », Lévi-Strauss écrit que si la forme se définit par opposition à la matière, la structure est le contenu même, “appréhendé dans une organisation logique conçue comme propriété du réel ». Si le structuralisme s’est parfois érigé en doctrine, il désigne d’abord, comme le rappelait Derrida, « une aventure du regard » et « une conversion dans la manière de questionner devant tout objet ». Y compris lorsqu’il s’agit de l’histoire.
Comme en témoigne de nombreuses publications et expositions de cette dernière décennie, il existe un regain d’intérêt pour les pratiques artistiques et théoriques qui investissent le passé au profit d’une écriture plurielle et plastique de l’histoire. Parallèlement, et dans ce contexte, de nombreux chercheurs tentent de redonner une place à l’approche structurale pour souligner sa fécondité historique et méthodologique comme en atteste les travaux de Giovanni Careri ou encore de Patrice Maniglier qui contribuent à ce dossier.
Les contributions ici rassemblées réinterrogent la notion de structure comme outil d’interprétation dans le domaine de la création. Il s’agit d’en examiner les ressources et les limites en prenant pour point d’attention principal les relations entre l’œuvre d’art et l’histoire. Trois dossiers d’artistes viennent apporter leur éclairage sensible.
La seconde partie de ce volume est consacrée à l’une des figures marquantes de l’analyse structurale. Les contributions rassemblées autour de l’œuvre d’Algirdas Julien Greimas montrent à quel point les hypothèses théoriques avancées par le sémioticien constituent encore aujourd’hui des outils d’analyse pour penser les arts plastiques. Si Greimas est connu pour ses recherches visant à formaliser l’univers du récit, certains de ses écrits abordent plus directement l’image et ses processus de signification. Partant de l’article de Greimas, “Sémiotique figurative et sémiotique plastique”, les contributions de ce dossier opèrent une mise à l’épreuve et un prolongement des intuitions de Greimas. Jean-François Bordron, par exemple, esquisse une analyse de quelques notions de cet article pour appréhender une théorie de l’image dans le cadre d’une épistémologie structuraliste, tandis qu’Angela Mengoni tente de montrer en quoi les auteurs qui se réclament aujourd’hui d’un « tournant iconique » empruntent des chemins déjà tracés par Greimas.Note de contenu : SOMMAIRE
Dossier : L’œuvre d’art entre structure et histoire
• Giovanni Careri : L’objet théorique entre structure et histoire
• Muriel Van Vliet : André Leroi-Gourhan et Claude Lévi-Strauss. Anthropologie et morphologie de l’art
• Miguel António Domingues : Fonderie & Manufacture de Métaux
• Didier Vaudène : Feuillets d’abîme I
• Alice Mara Serra : Image et structuration minimale : Derrida, Deleuze et Didi-Huberman
• Audrey Rieber : “Car l’espace aussi est un concept temporel” (P. Klee). La logique de l’image selon Gottfried Boehm
• Hugo Dumoulin : La série, le pouvoir, le diagramme. Trois concepts pour penser l’esthétique dans le moment philosophique des années 1960
• Judith Michalet : Synchronisme heuristique versus anachronisme fantasmatique. L’œuvre d’art entre deux sens de l’histoire
• Jehanne Paternostre : L’archive : entre réceptions et opérations
• Bénédicte Duvernay : L’avant-garde russe, le cubisme et l’idée de structure
• Filippo Fimiani : “Il faut détruire les oiseaux”. Mythes et histoires de l’artiste désœuvré
• Emmanuelle Chérel : Narrations postcoloniales depuis la France
• Thu-Van Tran : La décennie rouge 1971-1981
• Patrice Maniglier : Mai 68 en théorie (et en pratique)
Dossier : Greimas et la sémiotique de l’image
• Maria Giulia Dondero & Jean-Marie Klinkenberg : Après Greimas. Des tâches pour la sémiotique visuelle
• Jean-François Bordron : La sémiotique structurale de Greimas et la question de l’image
• Anne Beyaert-Geslin : L’imperfection de l’image : une histoire prolongée de l’esthésie
• Isabelle Rieusset-Lemarié : La sémiotique plastique : une iconologie baroque
• Marion Colas-Blaise : La sémiotique visuelle naissante : Greimas et sa postérité
• Gian Maria Tore : Limitations et illimitations d’une sémiotique de l’image. Figurativité, réflexivité, multiplicité
• Pierluigi Basso Fossali : La sémiotique visuelle de Greimas entre archéologie et actualité
• Angela Mengoni : Le tournant iconique et la sémiotique plastique de Greimas
Varia
• Chakè Matossian : Marcel Duchamp et le Séducteur kierkegaardien
• Jérôme Flas : Quelle est la part de l’œil dans l’esprit de la musique ? Réflexions sur La Naissance de la tragédieEn ligne : http://espace-livres-creation.be/livre/la-part-de-loeil-n-32/ [n° ou bulletin] n°32 (2018-2019) - 2018-11-01 - Dossier : « L’œuvre d’art entre structure et histoire » et « Greimas et la sémiotique de l’image » [texte imprimé] . - 2018.
Langues : Français (fre)
Catégories : Abonnenc, Mathieu K. (1977-....)
Anthropologie structurale
Archives -- Dans l'art -- Histoire et critique
Art -- Historiographie -- Histoire et critique
Art -- Recherche
Art et anthropologie -- Recherche
Art et littérature
Art mobilier préhistorique
Arts et histoire
Avant-garde (esthétique) -- Russie -- 1921-1953
Beau (esthétique)
Boehm, Gottfried (1942-....)
Buñuel, Luis (1900-1983). Le fantôme de la liberté
Chronologie -- Dans l'art
Constructivisme (art)
Constructivisme (art) -- URSS -- 20e siècle
Cranach, Lucas (1472-1553). Nymphe de la rivière allongée près de la fontaine
Déconstruction
Deleuze, Gilles (1925-1995) -- Critique et interprétation
Derrida, Jacques (1930-2004) -- Critique et interprétation
Dessin au crayon -- Guyane -- 21e siècle
Didi-Huberman, Georges (1953-....) -- Critique et interprétation
Domingues, Miguel Antonio (1982-....)
Duchamp, Marcel (1887-1968) -- Critique et interprétation
Duchamp, Marcel (1887-1968) -- Influence
École de Nice (mouvement artistique) -- Expositions -- Histoire et critique
Empreinte (art)
Espace (philosophie)
Esthétique -- 20e siècle -- Histoire et critique
Forme (esthétique)
Foucault, Michel (1926-1984) -- Et l'art
Gabo, Naum (1890-1977)
Greimas, Algirdas Julien (1917-1992). Sémantique structurale
Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
Husserl, Edmund (1859-1938)
Icônes (linguistique)
Illustrations -- Interprétation -- Recherche
Image (philosophie)
Installations (art) -- Bruxelles (Belgique) -- 21e siècle
Installations (art) -- Bruxelles (Belgique) -- Photographies
Kierkegaard, Søren (1813-1855) -- Et l'art
Klee, Paul (1879-1940)
Klein, Yves (1928-1962)
Leroi-Gourhan, André (1911-1986)
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781). Laokoon
Lévi-Strauss, Claude (1908 - 2009)
Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935)
Masques kwakiutl
Michel-Ange (1475-1564). Les Ancêtres du Christ
Musique -- Philosophie et esthétique
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). La Naissance de la tragédie
Perception (philosophie)
Philosophie de l'art
Portraits (peinture) baroques -- 16e siècle -- Aspect symbolique
Postcolonialisme et arts -- France -- Histoire et critique
Pouvoir (philosophie)
Reste (esthétique)
Retouche (photographie) -- Aspect symbolique
Scénographie d'exposition -- Histoire et critique
Sedira, Zineb (1963-....) -- Autobiographie -- Algérie
Sémiotique et art -- Recherche
Séries chronologiques -- Dans l'art
Structuralisme -- France -- 1968 (Journées de mai)
Structuralisme -- Recherche
Structuralisme et musique -- Critique et interprétation
Synchronicité -- Dans l'art
Temps (philosophie)
Tragédie grecque -- Histoire et critique -- Aspect philosophique
Tran, Thu Van (1979-....)
Vietnam -- Politique et gouvernement -- 1975-....
Vigo, Jean (1905-1934). L'AtalanteIndex. décimale : 7 Arts et Beaux-Arts Résumé : Le structuralisme a constitué un moment marquant de la pensée du XXe siècle opérant un nouage stimulant entre la linguistique, l’anthropologie, la psychanalyse et la philosophie. La notion de structure et ses postulats ont ainsi conduit à une critique à l’égard de la « forme ». Dans l’article décisif « La structure et la forme », Lévi-Strauss écrit que si la forme se définit par opposition à la matière, la structure est le contenu même, “appréhendé dans une organisation logique conçue comme propriété du réel ». Si le structuralisme s’est parfois érigé en doctrine, il désigne d’abord, comme le rappelait Derrida, « une aventure du regard » et « une conversion dans la manière de questionner devant tout objet ». Y compris lorsqu’il s’agit de l’histoire.
Comme en témoigne de nombreuses publications et expositions de cette dernière décennie, il existe un regain d’intérêt pour les pratiques artistiques et théoriques qui investissent le passé au profit d’une écriture plurielle et plastique de l’histoire. Parallèlement, et dans ce contexte, de nombreux chercheurs tentent de redonner une place à l’approche structurale pour souligner sa fécondité historique et méthodologique comme en atteste les travaux de Giovanni Careri ou encore de Patrice Maniglier qui contribuent à ce dossier.
Les contributions ici rassemblées réinterrogent la notion de structure comme outil d’interprétation dans le domaine de la création. Il s’agit d’en examiner les ressources et les limites en prenant pour point d’attention principal les relations entre l’œuvre d’art et l’histoire. Trois dossiers d’artistes viennent apporter leur éclairage sensible.
La seconde partie de ce volume est consacrée à l’une des figures marquantes de l’analyse structurale. Les contributions rassemblées autour de l’œuvre d’Algirdas Julien Greimas montrent à quel point les hypothèses théoriques avancées par le sémioticien constituent encore aujourd’hui des outils d’analyse pour penser les arts plastiques. Si Greimas est connu pour ses recherches visant à formaliser l’univers du récit, certains de ses écrits abordent plus directement l’image et ses processus de signification. Partant de l’article de Greimas, “Sémiotique figurative et sémiotique plastique”, les contributions de ce dossier opèrent une mise à l’épreuve et un prolongement des intuitions de Greimas. Jean-François Bordron, par exemple, esquisse une analyse de quelques notions de cet article pour appréhender une théorie de l’image dans le cadre d’une épistémologie structuraliste, tandis qu’Angela Mengoni tente de montrer en quoi les auteurs qui se réclament aujourd’hui d’un « tournant iconique » empruntent des chemins déjà tracés par Greimas.Note de contenu : SOMMAIRE
Dossier : L’œuvre d’art entre structure et histoire
• Giovanni Careri : L’objet théorique entre structure et histoire
• Muriel Van Vliet : André Leroi-Gourhan et Claude Lévi-Strauss. Anthropologie et morphologie de l’art
• Miguel António Domingues : Fonderie & Manufacture de Métaux
• Didier Vaudène : Feuillets d’abîme I
• Alice Mara Serra : Image et structuration minimale : Derrida, Deleuze et Didi-Huberman
• Audrey Rieber : “Car l’espace aussi est un concept temporel” (P. Klee). La logique de l’image selon Gottfried Boehm
• Hugo Dumoulin : La série, le pouvoir, le diagramme. Trois concepts pour penser l’esthétique dans le moment philosophique des années 1960
• Judith Michalet : Synchronisme heuristique versus anachronisme fantasmatique. L’œuvre d’art entre deux sens de l’histoire
• Jehanne Paternostre : L’archive : entre réceptions et opérations
• Bénédicte Duvernay : L’avant-garde russe, le cubisme et l’idée de structure
• Filippo Fimiani : “Il faut détruire les oiseaux”. Mythes et histoires de l’artiste désœuvré
• Emmanuelle Chérel : Narrations postcoloniales depuis la France
• Thu-Van Tran : La décennie rouge 1971-1981
• Patrice Maniglier : Mai 68 en théorie (et en pratique)
Dossier : Greimas et la sémiotique de l’image
• Maria Giulia Dondero & Jean-Marie Klinkenberg : Après Greimas. Des tâches pour la sémiotique visuelle
• Jean-François Bordron : La sémiotique structurale de Greimas et la question de l’image
• Anne Beyaert-Geslin : L’imperfection de l’image : une histoire prolongée de l’esthésie
• Isabelle Rieusset-Lemarié : La sémiotique plastique : une iconologie baroque
• Marion Colas-Blaise : La sémiotique visuelle naissante : Greimas et sa postérité
• Gian Maria Tore : Limitations et illimitations d’une sémiotique de l’image. Figurativité, réflexivité, multiplicité
• Pierluigi Basso Fossali : La sémiotique visuelle de Greimas entre archéologie et actualité
• Angela Mengoni : Le tournant iconique et la sémiotique plastique de Greimas
Varia
• Chakè Matossian : Marcel Duchamp et le Séducteur kierkegaardien
• Jérôme Flas : Quelle est la part de l’œil dans l’esprit de la musique ? Réflexions sur La Naissance de la tragédieEn ligne : http://espace-livres-creation.be/livre/la-part-de-loeil-n-32/ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité SL 23434 Part de l'oeil Fascicule ESA Saint-Luc Beaux-Arts - Biblio Disponible
Titre : L’image comme problème Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernard Vouilloux (19..-....), Auteur Année de publication : 2025 Article en page(s) : P. 10-21 Langues : Français (fre) Catégories : Association internationale pour l'étude des rapports entre texte et image
Genette, Gérard (1930-2018)
Image (philosophie) -- Dans l'art
Marin, Louis (1931-1992)
Peinture -- Critique et interprétation
Représentation (esthétique)
Sémiotique et art -- Recherche
WeltanschauungIndex. décimale : 7.01 Esthétique, philosophie de l'art
in La part de l'œil > n°39 (2025) (2025-03-01) . - P. 10-21[article] L’image comme problème [texte imprimé] / Bernard Vouilloux (19..-....), Auteur . - 2025 . - P. 10-21.
Langues : Français (fre)
in La part de l'œil > n°39 (2025) (2025-03-01) . - P. 10-21
Catégories : Association internationale pour l'étude des rapports entre texte et image
Genette, Gérard (1930-2018)
Image (philosophie) -- Dans l'art
Marin, Louis (1931-1992)
Peinture -- Critique et interprétation
Représentation (esthétique)
Sémiotique et art -- Recherche
WeltanschauungIndex. décimale : 7.01 Esthétique, philosophie de l'art Quand la machine délire le dessin... : dossier thématique coordonné par / Johana Carrier ; Joana Neves ; Didier Semin ; Guitemie Maldonado ; Maëlle Dault ; Chris Cornish in Roven : revue critique sur le dessin contemporain, no.6(2011:automne/hiver) (2011-09-21)
PermalinkSchefer, Marin, Lyotard, 1969-1971. “Discours” et “figure”, une concurrence sémiologique ? / Benoît Tane in La part de l'œil, n°39 (2025) (2025-03-01)
Permalink